
Retour sur la Course destination monde avec Nathalie Cloutier
Retour sur la Course destination monde avec Nathalie Cloutier
Productrice au Programme français de l’Office national du film du Canada, Nathalie Cloutier a participé à la toute dernière édition de la Course destination monde, celle de 1998-1999. Je continue cette semaine ma série d’entrevues avec les anciens de la course qui ont travaillé à l’ONF (ou qui y travaillent toujours) et avec l’une des rares participantes qui n’a jamais eu l’intention de devenir cinéaste…
Catherine Perreault : Tu as participé à la Course destination monde de 1998-1999. Peux-tu nous dire ce qui différencie cette course des autres?
Nathalie Cloutier : C’était la dernière année de la course. Les choses avaient beaucoup changé depuis les débuts de la série, dix ans plus tôt. Vers la fin des années 1990, par exemple, nous avions accès à l’Internet partout dans le monde.
Quels pays as-tu visités?
Une agence de voyages était attitrée à la course. Nous devions tous rencontrer une agente avant de partir, puis déterminer notre parcours avec elle. Pour l’anecdote : mon agente était la mère de Manuel Foglia, qui a fait la course de 1992-1993. Chaque coureur avait un budget d’environ 9 000 $ pour faire le tour du monde. Il fallait donc bien planifier notre itinéraire.
En 1998-1999, nous suivions le concept « Destination monde ». Nous avions donc le loisir d’aller partout sur la planète. Cependant, avec le budget et le temps alloué, nous devions faire des choix judicieux. Par exemple, je n’aurais pas pu à la fois traverser toute l’Amérique du Sud et visiter l’Afrique. C’était trop coûteux. Il fallait être stratégique et éviter de partir d’un bout à l’autre de la terre.
Certains ont choisi leurs pays en fonction des sujets qu’ils avaient préalablement trouvés. Pour ma part, j’ai suivi mes coups de cœur : ceux que je voulais vraiment visiter. Je me suis demandé : « Où est-ce que je n’aurai jamais plus la chance d’aller? »
Cette étape fut un des moments forts de la course pour moi. Je me rappelle m’être assise sur la chaise devant l’agente de voyage. Je réfléchissais à où j’avais envie d’aller et, surtout, à où j’allais trouver quelque chose à raconter.
Mon choix s’est d’abord arrêté sur l’Afrique du Sud. À l’époque, l’apartheid était supposément terminé depuis 10 ans. Je suis allée voir ce qui en était. Je suis aussi allée au Zimbabwe, juste à côté.
Ensuite, je suis montée en Syrie, puis en Arménie, au Pakistan, au Kazakhstan, en Inde, en Chine et au Japon. J’ai construit mon itinéraire selon cette forme d’arche.
On est loin du tourisme de plaisance…
Je n’avais pas préparé une liste de sujets précis avant de partir, mais je savais qu’il se passait des choses dans ces pays-là. Je savais, par exemple, qu’il y avait eu un génocide en Arménie. Je savais aussi que le Pakistan était un pays musulman et que la situation des femmes était particulière, même si l’on n’en parlait pas beaucoup dans les médias à l’époque.
Par contre, je ne voulais pas raconter que des histoires collées sur l’actualité. J’avais d’ailleurs choisi le Kazakhstan pour y faire un film plus poétique. Je m’étais fait une idée romantique des plaines de l’Asie centrale. Je m’attendais à y voir de beaux Kazakhs sur leurs chevaux… Une fois arrivée là-bas, j’ai plutôt décidé de faire un film sur le polygone nucléaire de Semipalatinsk situé dans le nord du pays, où il y a eu plusieurs essais nucléaires. Au final, ce fut un de mes très bons films.
Je me rappelle que la télévision de Radio-Canada était allée faire un reportage sur ce même sujet par la suite. Ils y avaient envoyé le journaliste Jean-François Lépine. Je suis très fière d’avoir été l’une des premières à braquer ma caméra dans cette direction.
Qu’as-tu le plus aimé de la course?
Je garde un excellent souvenir de l’ensemble de mon expérience à l’étranger. Pendant six mois, je devais faire un film tous les neuf jours. Les miens ont d’ailleurs tous été livrés en retard (rires). Tu changes de ville et de pays, tu trouves ton sujet, tu trouves la manière de l’aborder et tu tournes ton film. Ça n’arrête pas. Parfois, nous pouvions rester plusieurs jours dans un même pays. Ce qui nous facilitait grandement la tâche. Mais lorsque nous arrivions dans un nouveau lieu et que nous devions y tourner un film en neuf ou dix jours, c’était tout un défi. Un défi que nous répétions semaine après semaine pendant six mois.
Au Zimbabwe, je suis restée chez une famille canadienne qui accueillait les participants de la course chaque année. J’ai détesté ça! Les gens étaient très gentils, mais où était le dépaysement? Je n’étais pas partie de la maison depuis dix ans. Je n’avais pas besoin de retrouver mon chez-moi, au contraire.
Après cette expérience, j’ai évité ce type de situation le plus possible. Je dormais à l’hôtel ou ailleurs, mais j’essayais de ne pas trop avoir de contacts avec la maison. Je ne prenais presque jamais mes courriels. Je voulais vivre l’immersion totale! Mes meilleurs souvenirs de la course sont ceux où je suis complètement déconnectée de mon quotidien.
Parlant de connexion, comment communiquiez-vous avec l’équipe de production?
Nous devions entrer régulièrement en contact avec l’organisation de la course. Nous devions prévoir des conversations téléphoniques en direct pendant les émissions de télé et préparer des présentations filmées de nous-mêmes. Nous devions aussi réaliser de faux duplex, sorte de conversations filmées avec des gens qui se trouvaient à Montréal.
Cette année-là, chaque participant ou participante de la course était jumelé avec un parrain ou une marraine. La mienne était Sophie Lambert, une ancienne de la course. On s’était donné un concept pour notre duplex. On devait se filmer séparément, chacune de son côté, en train de se parler au téléphone. J’accrochais mon linge sur une corde dans ma chambre d’hôtel, tandis que Sophie mettait le sien dans sa sécheuse à Montréal.

Est-ce qu’il y a des éléments qui t’ont déçu de la course?
Ce que j’ai moins aimé, c’est l’aspect « télévision » de la course. C’est étrange, puisque, Course autour du monde, c’est une émission. J’ai aimé faire mes films pour qu’ils soient diffusés, mais j’aimais moins le fait d’être une personnalité publique et d’avoir à faire partie d’un show de télé.
À notre retour à Montréal, après la course, nous étions traités comme des vedettes. Nous nous faisions inviter à toutes sortes d’émissions. Je manquais peut-être de maturité, mais je trouvais que ça n’avait « pas rapport ». À mes yeux, je n’étais rien. Aujourd’hui, je sais faire la part des choses. Il y a tout un concept derrière cette émission qui nous a permis de voyager. Ce concept inclut, nous, les jeunes avec nos personnalités. Nous faisons partie du show. Mais il faut comprendre que je venais de faire le tour du monde. Ma perspective était différente. Je venais de réaliser à quel point je n’étais qu’une goutte dans l’océan. À l’autre bout du monde, je n’étais qu’un simple être humain parmi tant d’autres.
Qu’as-tu fait après la course?
Contrairement à la plupart des autres participants, je n’avais pas envie de devenir réalisatrice. Pour moi, réaliser un film ou aider à raconter une histoire, ce sont deux choses distinctes.
Chaque participant de la course vit le retour au Québec de manière différente. Personnellement, je me suis cachée. Je voulais juste disparaître. Je suis donc partie faire des projets de films indépendants au Chili et à Cuba avec l’organisation Alternatives.
Ensuite, je suis retournée sur le marché du travail.
Dans quel domaine?
Avant la course, je travaillais dans un centre d’appels mis sur pied par un groupe d’amis. À mon retour, l’entreprise avait pris de l’ampleur, alors ils m’ont offert un poste de chargé de projets. Je travaillais sur de gros contrats, mais je ne suis pas restée longtemps. Après tout ce que j’avais vécu, je ne me voyais pas rester là.
L’ONF cherchait quelqu’un pour travailler au service à la clientèle. J’ai appliqué et j’ai eu l’emploi. Ce qui m’intéressait surtout, c’était le statut temps partiel du poste. Ça me permettait de réaliser parallèlement des projets.
En commençant à travailler, j’ai constaté qu’il y avait des studios de production à l’ONF. Je n’avais honnêtement pas fait le déclic au moment de postuler. Je suis donc allée voir les ressources humaines pour leur demander s’il y avait de l’embauche dans les studios, et on m’a parlé d’un poste de coordination de production. J’ai tenté ma chance et j’ai obtenu le contrat. C’est comme ça que je suis entrée au Programme français.
Christiane Germain était la productrice déléguée du Studio A à ce moment-là. C’est donc en travaillant à ses côté que j’ai découvert les métiers liés à la production. Elle a eu une grande influence sur ma carrière.
Je travaillais également aux côtés de la productrice Colette Loumède. Je me suis mise à examiner de près ce qu’elle faisait et j’ai vite compris que les producteurs avaient un rôle important à jouer dans la création des films. C’est à ce moment-là que je sais su que je voulais devenir productrice.
Comment es-tu passé de coordonnatrice de production à productrice à l’ONF?
En 2008, alors que j’étais coordonnatrice, Monique Simard a été nommée à la tête du Studio français de l’ONF. Elle a dû couper des postes. Puisque j’étais la dernière entrée dans mon secteur, j’ai été la première coupée.
Tu ne lui en veux pas trop?
Non, au contraire. Monique et les responsables des ressources humaines à l’ONF ont été fantastiques. Je la taquine un peu aujourd’hui en lui disant qu’elle n’a pas su se débarrasser de moi, mais en réalité, je plafonnais à l’ONF. J’avais l’ambition de devenir productrice. Je suis donc allée suivre un cours de production à L’institut national de l’image et du son (INIS). Après mon cours, je suis revenue à l’ONF pour travailler au sein de l’équipe de production de PIB – L’indice humain de la crise économique canadienne. J’y ai acquis une expérience de production interactive. Quand mon contrat sur PIB s’est terminé, un poste de productrice s’est libéré au Programme français et j’ai eu la chance de l’obtenir.
Sur quoi travailles-tu présentement?
Je travaille sur plusieurs projets en même temps. Le prochain qui va sortir est le volet Web de Trou Story.
Colette Loumède a produit ce documentaire de Richard Desjardins et de Robert Monderie, et je me suis occupée du volet interactif sous la supervision d’Hugues Sweeney d’ONF/Interactif. C’est une production unique et indépendante au film. On ne voulait pas juste mettre en ligne des extraits du documentaire.
On a utilisé un module interactif qui utilise Google Maps pour que les internautes puissent faire l’expérience (virtuelle) de l’exploitation minière dans leur cour. C’est une expérience qui leur permettra de mieux comprendre ce qui se passe en Abitibi et dans le nord du Québec.
Aimerais-tu te spécialiser en production Web?
Je travaille autant sur des documentaires traditionnels que sur des projets interactifs. Honnêtement, je ne vois pas les productions Web comme étant différentes des autres productions. Le produit est différent, certes, mais au final, un projet est un projet. Je les aborde tous de la même manière.
Dans le cas de Trou Story, c’était vraiment l’occasion de concevoir un projet de documentaire sur le Web. Mais je travaille aussi à réaliser des projets de documentaires. Certains sont en route. Je travaille présentement sur un projet du cinéaste Pierre Goupil. Un film dans lequel le cinéaste nous raconte, à sa manière, sa prise de contact avec la maladie mentale.
Je collabore également au prochain film de Laura Baril, Ariel. Cette œuvre est coproduite par Parabola Films, avec qui l’ONF a aussi coproduit À St-Henri, le 26 août. Elle raconte l’histoire d’un homme qui, les ayant perdues dans un terrible accident, décide de se fabriquer lui-même ses jambes.
Aimes-tu ton métier de productrice?
Ça fait maintenant un an que je suis productrice à l’ONF, et j’ai vraiment l’impression d’avoir trouvé ma voie.
Vous pourrez expérimenter le projet Web de Trou Story à <ONF.ca/TrouStory> dès le 1er novembre 2011.
Le documentaire de Richard Desjardins et de Robert Monderie sera présenté en première mondiale le 30 octobre au Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscaminque.



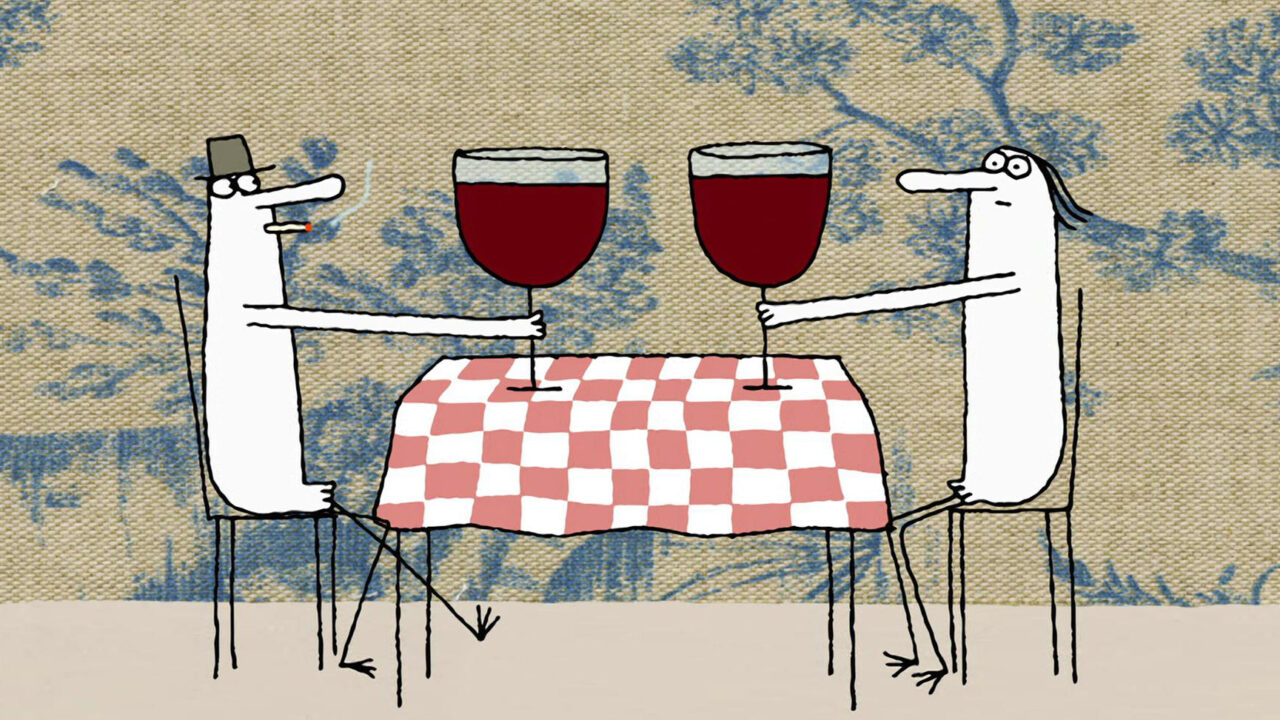
Bonjour,
Bravo pour votre parcours. Néanmoins, le Pakistan n’est pas un pays arabe mais un pays musulman, ce qui est très différent…
Bonjour Aouad,
Merci pour cette précision importante. Je vais modifier l’info dans le texte.
Heureuse de savoir que le parcours de Nathalie Cloutier vous a plu.
Catherine