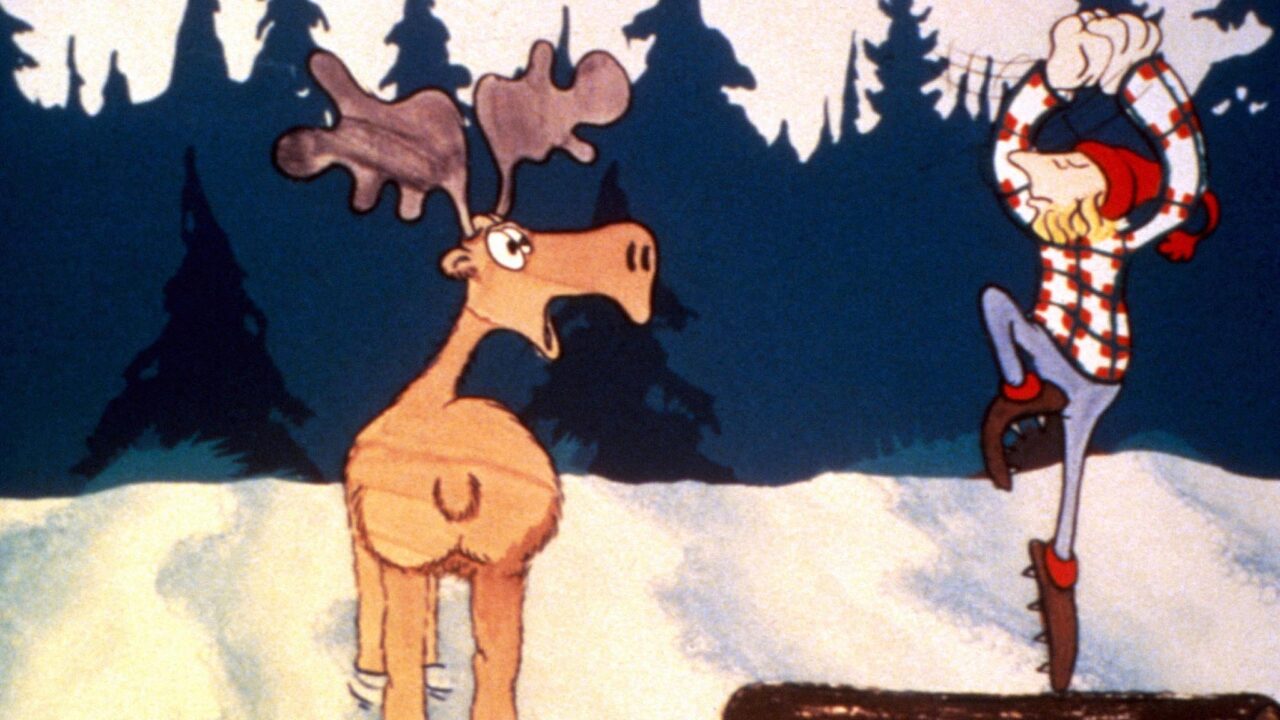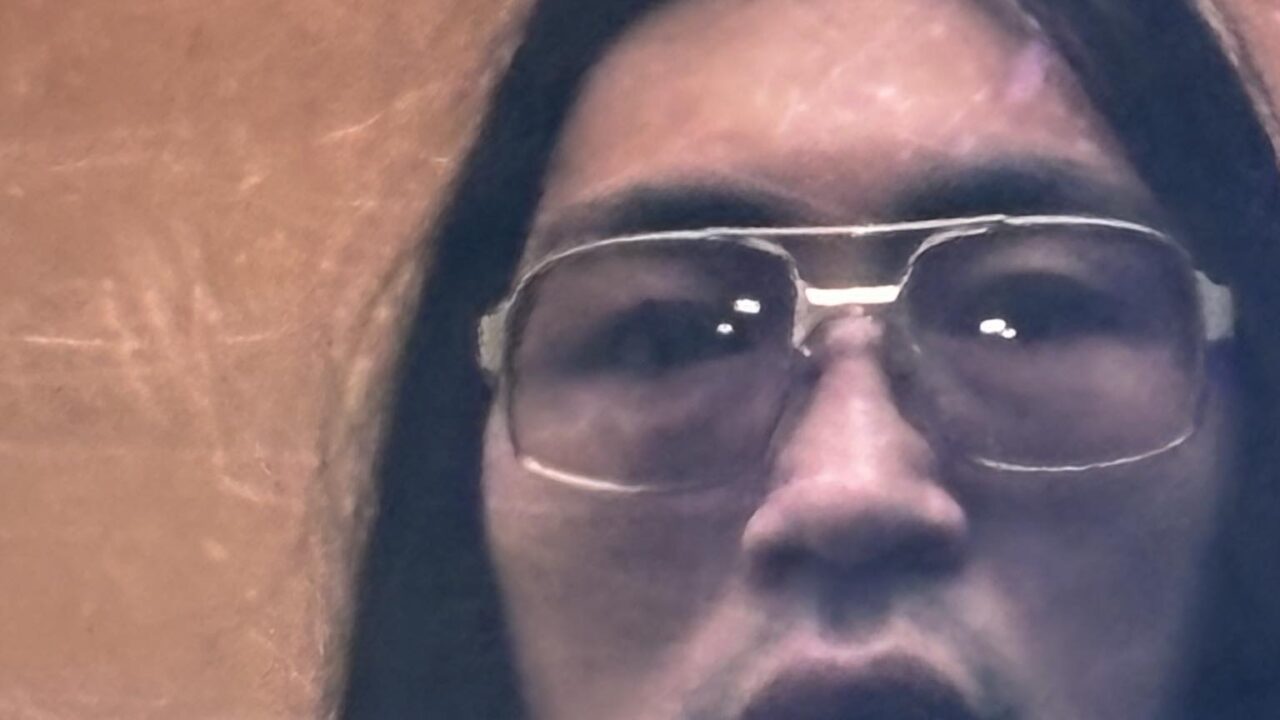
Les bobines perdues de l’Atelier Super 8 du Nunavut : Mosha Michael
Les bobines perdues de l’Atelier Super 8 du Nunavut : Mosha Michael
Pour poursuivre notre exploration d’un des chapitres les plus intrigants du cinéma autochtone à l’ONF, intéressons-nous à l’Atelier Super 8 de Frobisher Bay, lancé dans la foulée du succès de l’Atelier de cinéma d’animation de Cape Dorset (couvert en détail dans mes deux billets précédents, ici).
Natsik Hunting, Mosha Michael, offert par l’ Office national du film du Canada
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous recommande fortement de visionner Natsik Hunting (1975), un court métrage de Mosha Michael qui illustre parfaitement le potentiel créateur de l’atelier de Frobisher Bay. Première réalisation du cinéaste alors âgé de 27 ans, cette œuvre d’observation de sept minutes dépeint une chasse au phoque traditionnelle inuit. Fait étonnant, le court métrage est dépourvu de toute narration ; ce sont plutôt les compositions guitare-voix de Michael — créées en collaboration avec Etulu Etidloie, un participant à l’atelier de Cape Dorset — qui constituent la trame sonore de Natsik Hunting, ce qui démontre la capacité du réalisateur à allier la chronique culturelle et l’expression artistique.
De l’animation à un atelier de réalisation en Super 8 au Nunavut, 1975
L’une des principales raisons du passage de l’animation aux prises de vues réelles à l’ONF se résume à des facteurs logistiques : bien que Tarqravit (la première émission télévisée inuit à la CBC) avait accepté de diffuser un large éventail de contenus inuit — y compris des courts métrages d’animation et en prises de vues réelles, ou un mélange de films d’animation, de portraits en prises de vues réelles et d’entrevues avec des gens de la région —, il n’y avait pas assez d’Inuit disponibles au Nunavut pour faire des tournages toutes les semaines et fournir 15 minutes d’enregistrements à la CBC (et le Studio d’animation Sikusilarmiut n’était pas non plus en mesure de produire 15 minutes de film par semaine pour alimenter la programmation de Tarqravit !).
Toutefois, reconnaissant d’une part le succès du Studio d’animation Sikusilarmiut, d’autre part le besoin grandissant de contenu produit localement, l’ONF a décidé de fermer le studio-atelier d’animation de l’île de Baffin, pour plutôt fonder un atelier arctique de tournage en Super 8, axé sur la prise de vues réelles, à Frobisher Bay (aujourd’hui Iqualuit), sous la supervision de Corrine Corry et de Phil Schmidtz. Les apprentis de Cape Dorset Timmun Alariaq et Etulu Etidloie se sont rendus à Frobisher Bay pour épauler les membres du nouvel atelier[i].
Ce nouvel atelier de l’ONF visait à former des artistes inuit de la région au tournage en Super 8 — un médium plus accessible et pratique — afin d’assurer un flux constant de contenu pour la programmation hebdomadaire de la CBC. Fondé à la mi-mai 1975, il comptait parmi ses stagiaires Anne Hanson, Elisapee Davidee, Buck Buck, Jamesee Temotee Mitsima, Meeka Wilson, Mark Tat-Krook, Seemeonie Michael, Nanasie Nowdlak, Ooleepeeka Gordon et Leevee Nowdluk (en plus d’élèves de l’école Nakashuk, âgés d’en moyenne 10 ans, et d’élèves du Centre d’éducation Gordon Robertson, qui y ont participé durant les heures de classe)[ii].
Parmi ces participantes et participants, Mosha Michael a joué une gamme de rôles particulièrement polyvalents, agissant à la fois comme caméraman, réalisateur, monteur et compositeur pour l’ensemble des films, dont Natsik Hunting (voir ci-dessus), et la suite de celui-ci, intitulé The Hunters (Asivaqtiin) (1977). Ce dernier documente un voyage de chasse de trois semaines dans l’Arctique organisé comme programme de réinsertion destiné aux jeunes contrevenants et à leur famille. Le film, dont la musique originale a été composée par Kowmageak Arngnakolak et Michael lui-même, est depuis devenu un jalon du cinéma autochtone produit par l’ONF.
The Hunters (Asivaqtiin), Mosha Michael, offert par l’ Office national du film du Canada
Mosha Michael
Bien que certains documents de l’ONF indiquent que plusieurs films auraient été réalisés à l’atelier[iii][iv] et que d’autres titres auraient été enregistrés ou réalisés par Mosha Michael[v], à ce jour, les seules œuvres issues de cette initiative ayant été retrouvées sont les films de Michael présentés dans ce billet[vi].
Né en 1948 dans un camp isolé près d’Apex (Niaqunngut), en périphérie d’Iqaluit, Michael est considéré comme le premier documentariste inuk. Survivant des pensionnats, il a maîtrisé presque tous les aspects du cinéma, assumant tour à tour les fonctions de recherchiste, de scénariste, de réalisateur, de caméraman, de monteur, de narrateur, de compositeur et musicien (chanteur).
Récemment redécouvert, restauré et numérisé, le troisième et dernier film de Michael produit par l’ONF, Whale Hunting (Qilaluganiatut) (1977), retrace le parcours de six Inuit partis à la chasse au béluga près d’Iqaluit. La trame sonore originale met de nouveau en valeur la musique et les chansons d’Arngnakolak et du réalisateur lui-même. Les trois projets de Michael réalisés à l’ONF ont été tournés en Super 8 et offrent le regard rare d’un cinéaste local sur les paysages et les coutumes de l’île de Baffin dans les années 1970.
Whale Hunting (Qilaluganiatut), Mosha Michael, offert par l’ Office national du film du Canada
Contrairement à la dissolution du Studio d’animation Sikusilarmiut, attribuable à plusieurs facteurs, l’Atelier Super 8 de Frobisher Bay s’est désintégré principalement en raison de l’absence de rémunération, ce qui a contraint les cinéastes à se tourner vers d’autres emplois (à la radio de la CBC et à l’Inuit Tapirisat)[vii]. Michael a par la suite travaillé pour l’Inuit Broadcasting Corporation et, en 1985, il s’est installé à Toronto pour poursuivre sa carrière de réalisateur et suivre des cours de photographie à l’Université Ryerson (aujourd’hui l’Université métropolitaine de Toronto). N’ayant pu continuer à faire du cinéma, il a gagné sa vie comme sculpteur sur stéatite, jusqu’à son décès en 2009. Ses cendres ont été dispersées dans la rivière Apex[viii].
La fin de l’atelier et la naissance de la Société cinématographique Nunatsiakmiut : 50 ans de cinéma inuit
L’atelier de Frobisher Bay a finalement été dissous, en partie parce que, le 23 janvier 1976 — soit à peine huit mois après son lancement —, une nouvelle occasion s’est présentée de transcender le format limité de Tarqravit. Un collectif inuit a fondé la Société cinématographique Nunatsiakmiut, qui avait pour but de créer une émission de télévision plus ambitieuse et centrée sur la culture inuit. Contrairement à Tarqravit, qui proposait des segments de 15 minutes, cette nouvelle initiative visait à produire 30 minutes de programmation hebdomadaire pour la CBC, entièrement réalisée par des cinéastes et des techniciens et techniciennes inuit, sur des sujets inuit et dans des langues inuit. Ce changement a marqué une étape déterminante vers un plus grand contrôle inuit sur la production médiatique et la narration. L’atelier (structuré sous la direction de cinq personnes : Corrine Corry à titre de formatrice et de conseillère, Michael à la caméra, Nowdluk et Gordon au montage sur magnétoscope et Nowdlak comme assistante à la production) a produit de nombreux films à l’aide de l’équipement de l’ONF, principalement destinés à alimenter la programmation de la CBC pour la Société cinématographique Nunatsiakmiut. On pourrait dire que l’atelier de l’ONF n’a pas réellement pris fin, mais qu’il s’est plutôt transformé en société de production au service de Nunatsiakmiut.
Trois mille, Asinnajaq, offert par l’Office national du film du Canada
L’héritage des ateliers est manifeste aujourd’hui, après 50 ans de présence active de l’ONF dans le cinéma au Nunavut, qui a abouti à des œuvres majeures comme Trois mille (2017, intégrée ci-dessus), Chanson de l’Arctique (2021) et La nuit du Nalujuk (2021), présentées à l’échelle internationale et lauréates de centaines de prix. Bien plus qu’un simple épisode du passé, les initiatives d’ateliers menées par l’ONF au Nunavut dans les années 1970 ont joué un rôle déterminant dans l’émergence de la souveraineté culturelle des Inuit et dans leur capacité à raconter leurs propres histoires.
L’Atelier de cinéma d’animation de Cape Dorset et l’Atelier Super 8 de Frobisher Bay, tous deux mis en place par l’ONF, ont déclenché un double mouvement créatif : une nouvelle vague d’animation au Nunavut, exemplifiée par les œuvres du Studio d’animation Sikusilarmiut, et une montée parallèle du cinéma documentaire, illustrée par le travail de Michael Mosha présenté dans ce blogue. Ces ateliers ont également contribué à des percées remarquables pour les Inuit : des projections dans de grands festivals (pour les créations du Studio d’animation) et des prix remportés, mais aussi la création d’émissions de télévision réalisées par des Inuit, pour les Inuit, en inuktitut, ou comme moyen de préserver leur langue, leurs valeurs et leurs traditions (dans le cas des documentaires en Super 8 de Michael).
Des émissions comme Tarqravit et les contenus produits par Nunatsiakmiut pour la CBC sont devenus un modèle pour la diffusion dirigée par des Autochtones, puisqu’ils décentralisent le contrôle éditorial exercé depuis le Sud et assurent l’authenticité linguistique et culturelle (ce qui a possiblement inspiré la création de l’Inuit Broadcasting Corporation… mais c’est là un sujet qui mériterait son propre billet de blogue).
Par-dessus tout, ces initiatives ont permis de mettre en place une infrastructure et de former des techniciens et techniciennes, aidant ainsi les artistes et producteurs locaux à documenter la vie inuit selon leur propre perspective. En somme, les ateliers ont posé les bases matérielles de l’avenir du cinéma au Nunavut. Et vous pouvez célébrer cette aventure longue de 50 ans en visitant la chaîne sur le cinéma inuit de l’ONF et en visionnant quelques-unes de ces perles du Nord !
Bon visionnement !
Arctic Workshop Reel 3, , offert par l’ Office national du film du Canada
Veuillez noter que ce billet est le troisième volet de ma série sur les « ateliers arctiques » de l’ONF. Suivez ce lien pour lire la première partie : « Les bobines perdues de l’atelier d’animation du Nunavut : Le commencement ».
[i] Archives de l’ONF — Reportage sur l’Atelier de Frobisher Bay.
[ii] ibid.
[iii] p. ex., Making a Sweeping Broom et Mary Alice Accordian par Elisapee Davidee ; Apex — The Phase Out of an Old Summer Camp par Jamesee Temotee Mitsima ; Ravens par Seemeonie Michael ; Toonuk Tyme par Noah Nakashook ; Creeks and Rivers par Anne Hanson ; et Ring Making par Buck Buck.
[iv] Certains documents mentionnent également que les participantes et participants de l’atelier se sont essayés à la fiction, notamment avec « des drames servant à illustrer des notions juridiques élémentaires » et avec « les bandes dessinées d’action rapide de Markoosie », répertoriés parmi les projets produits dans le cadre de l’Atelier Super 8 de Frobisher Bay.
[v] p. ex., Peregrine Falcons, Carving Aoupalota et Ilevik Making Whip; Michael a également œuvré comme caméraman local pour un nombre indéterminé d’émissions de la CBC. (https://www.isuma.tv/sites/default/files/attachments/180817_isuma-ibc_channel-video_desc-shareable.pdf)
[vi] Elisapee Davidee est devenue animatrice à la CBC.
[vii] Archives de l’ONF — Reportage sur l’Atelier arctique.
[viii] Kira Wronska Dorward, « Inuk filmmaker Mosha Michael: “Something to look at”», Nunavut News, 17 juin 2024.